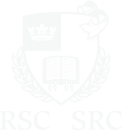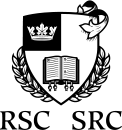LA CONDITIONNALITÉ EST LA CLÉ DE LA DÉFINITION D’UN AVENIR POST-COVID-19
Peter Dietsch | 11 mai 2020
En l’absence de conditionnalité, les décisions de gestion de crise risquent de saper les objectifs politiques à long terme
Télécharger l'article au complet
« Faisons du monde de l’après-pandémie un monde plus durable sur le plan social et environnemental ». Ce sentiment est partagé aujourd'hui par les décideurs politiques et les académiques. Parallèlement, de nombreuses décisions de gestion de crise prises par les gouvernements, les banques centrales et d'autres institutions publiques évoquent l’idée qu’« il n'y a pas d'autre choix » en ce qui concerne les politiques utilisées dans l'immédiat pour soutenir le système économique et financier.
Le décalage entre les louables intentions de changement à long terme et les contraintes subies à court terme n'est pas seulement déconcertant, il est aussi potentiellement nuisible. Il ne tient pas compte des leçons importantes tirées des récentes crises, notamment la crise financière de 2008 : les décisions de gestion de crise à court terme peuvent avoir des effets secondaires importants, parfois involontaires, qui sapent les objectifs fondamentaux de la politique sociale.
Deux choses peuvent être entreprises pour minimiser ces conséquences contre-productives de notre réponse politique à la Covid-19. Premièrement, les discours résignés, laissant penser qu’aucun autre choix n’est possible, doivent nous lasser. Dans de nombreux cas, il existe des alternatives politiques. Le défi consiste à les mettre à l'ordre du jour politique et à inciter les forces politiques à les adopter. Deuxièmement, la stratégie visant à promouvoir une réponse d'urgence sensible aux effets secondaires potentiels peut être résumée en un mot : la conditionnalité.
Cette conditionnalité a plusieurs dimensions. En voici trois qui reflètent les objectifs politiques généraux et fondamentaux du Canada.
Protéger les intérêts des contribuables
Il n’est pas vain de répéter la maxime classique des opérations de sauvetage (‘bail-outs’) menées par les gouvernements : éviter un scénario de privatisation des profits et de socialisation des pertes. En d'autres termes, si les gouvernements fédéral et provinciaux aident aujourd'hui les entreprises avec la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), des prêts bon marché ou d'autres mesures, ils devraient demander le remboursement de la plus grande partie, voire la totalité, de cet argent par l’intermédiaire des futurs bénéfices. Des exceptions raisonnables peuvent se justifier pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles le fardeau de la dette qui en résulterait serait insoutenable. En outre, dans un objectif de partage équitable du fardeau de la crise, toute aide devrait être subordonnée à la condition que les entreprises n'utilisent pas de stratagèmes agressifs d'évitement fiscal pour réduire leurs impôts au Canada - une mesure adoptée par plusieurs pays européens - et qu'elles ne versent pas de primes aux dirigeants ou de dividendes aux actionnaires avant que l'argent ne soit remboursé.
Lorsque la fin de la crise connaitra une augmentation de la dette souveraine, ce type de conditions inhérentes au soutien financier allégera la pression sur les budgets publics. Elles nous permettront d'éviter les mesures d'austérité peu judicieuses adoptées dans les années post-2008. Si les niveaux insoutenables de la dette publique sont effectivement préoccupants, l'austérité représente également une atteinte aux intérêts des contribuables. Elle leur demande de continuer à remplir les coffres publics, alors que la disponibilité des biens et services correspondants est réduite.
En outre, l'austérité est problématique car le fardeau des coupes budgétaires publiques tend à peser de manière disproportionnée sur les plus démunis. Ce constat nous amène à la deuxième dimension de la conditionnalité.
Limiter les effets secondaires inégalitaires de la réponse à la crise
Lorsque les marchés financiers des obligations d'État ont montré des signes de tension en mars 2020, de nombreuses banques centrales sont retournées directement à leurs habitudes de la crise financière de 2008. Elles ont lancé divers programmes d'achat d'actifs, également connus sous le nom d'assouplissement quantitatif, par lesquels les banques centrales assurent le bon fonctionnement des marchés en question en injectant des quantités importantes de liquidités dans l'économie. La Banque du Canada, par exemple, a lancé cinq programmes d'achat d'actifs différents pour les dettes publiques et commerciales. Elle a également renforcé ses facilités de prêt au secteur bancaire canadien.
Lorsque les marchés financiers sont sur le point de geler, la politique du « il n’y a pas d’autre choix » justifie facilement de tels programmes. Toutefois, au lendemain de la crise financière de 2008, nous avons tiré deux leçons importantes. Premièrement, au fil du temps, la justification de ces mesures tend à passer du sauvetage du système financier à la stimulation de l'économie. Lorsque cela se produit, la politique du « il n’y a pas d’autre choix » ne permet plus de justifier cette stratégie. D'autres mesures, telles que les transferts directs d'argent liquide à tous les citoyens, également appelé « l’hélicoptère monétaire », sont des options réalisables.
Deuxièmement, après 2008, une part importante des liquidités a été injectée dans des actifs financiers existants tels que des actions et des biens immobiliers, gonflant ainsi les bulles spéculatives. Les riches sont devenus plus riches, et les pauvres sont restés pauvres. En 2014, Mark Carney, alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, reconnaissait que « les conséquences de répartition de la réponse à la crise financière ont été importantes ». Les mandats des banques centrales les rendent largement insensibles à ces conséquences, mais en tant que société, nous les ignorons à nos risques et périls.
Ce type de politique monétaire n’est qu’un exemple. De manière générale, toute mesure d'aide économique prise dans le contexte de la Covid-19 devrait être conditionnée à la prise en compte des effets secondaires non intentionnels, mais prévisibles, qu'elle aura sur l'inégalité économique au Canada.
Respecter le principe du pollueur-payeur
Un cours d'introduction à l'économie de l'environnement présente la problématique du changement climatique en indiquant que certaines activités économiques entraînent ce qu'on appelle des coûts sociaux non assumés par le producteur. Exemple : l'industrie aérienne ne paie pas les coûts sociaux engendrés par ses émissions de gaz à effet de serre. Résultat : un nombre de vols et un niveau de pollution inefficacement (et dangereusement) élevé.
La solution sur laquelle tous les économistes s’accordent est tout aussi simple : faire payer aux pollueurs les coûts sociaux engendrés par leurs activités - par exemple par une taxe sur le carbone qui reflète le coût social d'une tonne de gaz à effet de serre – pour que l'activité retombe à un niveau plus bas et plus efficace. Il n'est pas surprenant que les industries faisant une utilisation intensive de combustibles fossiles s’opposent à cette solution, car le non-paiement de ces coûts est au cœur de leur « modèle économique ». Dans la crise actuelle, elles ont même l'audace de demander au gouvernement canadien de revenir sur la législation climatique.
Que devrait faire notre gouvernement lorsque ces industries demandent un renflouement ? Conditionner le renflouement à la prise en charge des coûts sociaux de leurs activités. Soyons clairs sur ce que cela signifie. Cela ne signifie pas, par exemple, donner de l'argent au secteur du pétrole et du gaz pour nettoyer les puits abandonnés dans l'Ouest canadien, comme l'a fait Ottawa le 17 avril. Cela signifie une subvention qui couvre rétroactivement les coûts sociaux que l'industrie aurait dû assumer depuis le début. Au lieu de cela, elle appelle à des mesures qui feront en sorte que les pollueurs - producteurs et consommateurs - assument une plus grande part des coûts sociaux engendrés par leurs activités. À titre d’exemple, Ottawa pourrait conditionner son soutien à l'acceptation d'une réelle taxe sur le carbone, ou à une réglementation plus stricte concernant le démantèlement des puits de pétrole et de gaz. À cet égard, la réglementation canadienne est encore plus laxiste que celle des États-Unis, qui ne sont pas vraiment reconnus pour leurs réglementations environnementales strictes.
Dans l'immédiat, les préoccupations premières de la gestion de crise sont la santé physique des Canadiens ainsi que leur sécurité économique, et ce à juste titre. Cela dit, ce serait une grave erreur de reporter la construction d'une meilleure société post-pandémique à la disparition du virus. Chaque mesure prise à l’heure actuelle aura un impact durable sur les objectifs politiques fondamentaux de la société canadienne grâce à divers canaux de transmission.
En réagissant à la Covid-19, les décideurs politiques canadiens à tous les niveaux de pouvoir peuvent tirer des enseignements utiles d'autres crises récentes. Conditionner nos mesures politiques est essentiel si nous ne voulons pas que notre réponse à la crise actuelle allume la mèche de la prochaine, qu'elle soit fiscale, sociale ou environnementale.
Peter Dietsch est professeur de philosophie à l'Université de Montréal et travaille sur les questions d'éthique économique. Prof. Dietsch est membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada.