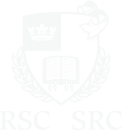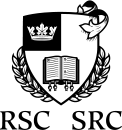CONTESTER LE POUVOIR DE L’ÉTAT PENDANT LES CRISES CONCURRENTES DE LA COVID-19
Stuart J. Murray | 29 mai 2020
Télécharger l'article au complet
La pandémie de COVID-19 n'est pas simplement une crise de santé publique. C'est un ensemble de crises multiples et intensément concurrentes, chacune engendrant des dommages collatéraux. Les deux crises les plus immédiates sont certainement biologiques et économiques : entre la vie et les moyens de subsistance. À certains égards, elles représentent des valeurs et des systèmes de régulation concurrents, mais elles sont également interdépendantes. Nous savons que la pauvreté et le stress, par exemple, sont d’importants déterminants sociaux de la santé, avec lesquels il est possible de prédire des résultats négatifs en matière de santé et une mort prématurée. Cela étant, nous savons aussi que la réouverture de l'économie entraînera nécessairement un certain nombre de maladies et de décès qui auraient été évitables, alors que les responsables de la santé publique tenteront de gérer les épidémies dans les nombreux mois à venir.
Dans son témoignage devant le Sénat américain le 12 mai, le Prof. Anthony S. Fauci a lancé un avertissement sans équivoque : la réouverture trop précoce de l'économie américaine entraînerait « des souffrances et des morts inutiles ». Cela étant, la mesure de la « souffrance » et la définition de « l'inutilité » ou de son contraire, la nécessité, diffèrent selon l’interlocuteur. Ce sont des termes glissants et séculaires, parfois même personnifiés. Chez les anciens Grecs, la déesse Ananke incarnait la nécessité, et dictait le sort des dieux et des êtres humains. Elle apparaît parfois aux côtés de la déesse Bia, un mot qui signifie force, pouvoir ou violence. À première vue, les contestataires des ordres de confinement donnés par le gouvernement semblent habiter un tel monde mythologique, animé par le destin et le spectre de la violence. Pour eux, la réouverture de l'économie est une nécessité. La gestion de la crise par l'État n'est considérée que comme une crise de gestion de l'État, où l'intervention de l'État est jugée inutile et malvenue, très suspecte ou même « socialiste ».
Des images très répandues prises dans de nombreuses grandes villes américaines montrent des vigiles armés jusqu'aux dents, occupant des bâtiments de l'État et prétendant défendre leurs « droits » et leurs « libertés » (termes également glissants). Nous assistons également à des manifestations contre le confinement dans des villes canadiennes et européennes, et partout dans le monde. Dans le contexte nord-américain, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les manifestations locales sont animées par la politique, l'idéologie ou la nécessité (je n'ai pas encore vu un panneau indiquant « J'ai faim »). Organisées librement sur les réseaux sociaux et parfois financées par des groupes conservateurs (dont au moins un ayant des liens apparents avec un membre de l'administration Trump), les manifestations américaines sont des rassemblements hétéroclites de libertaires radicalisés et de partisans de Trump.
Cela étant, malgré leurs différences, les manifestants du monde entier semblent unis dans leur volonté singulière de jouer avec le destin, d'assumer les risques - ou plus exactement, de forcer d'autres personnes plus vulnérables qu'eux à les assumer pour eux. Il ne s’agit pas de choisir entre « votre argent ou votre vie ». Il y a de fortes probabilités pour que la vie de quelqu'un d'autre qui soit mise en gage dans ce jeu, quelqu'un dont la souffrance et la mort seront « entre les mains du destin » : les affaires continuent. Cette situation est plutôt courante que macabre, ces économies sacrificielles sont généralement moins visibles qu’en période de pandémie de COVID-19.
Alors que des tendances à la baisse sont annoncées sur les courbes épidémiologiques, comment les communautés peuvent-elles apprécier le bon moment pour revenir à la « normale », et à quel rythme ? En d'autres termes, comment allons-nous naviguer entre les demandes - et les dommages collatéraux - de revendications concurrentes en matière de santé publique et de santé économique, de vies et de moyens de subsistance ? Même les gouvernements démocratiques les plus progressistes doivent tolérer un certain seuil de décès - une perte acceptable de vies humaines - pour la réouverture de leurs économies. Si nous connaissions ces chiffres, je pense que nous les trouverions scandaleusement élevés. Quelques décès seront « malheureux », peut-être « inévitables », mais quel est le seuil où des décès évitables en d’autres temps deviennent trop nombreux pour être acceptables ? Quelqu'un, quelque part, est en train de calculer ces chiffres et d'étudier calmement le niveau de tolérance à la mort acceptable par les électeurs. Malgré tous les discours sur la valeur inestimable de la vie, chaque vie a un prix, et certaines se voient attribuer une valeur sans aucun doute supérieure à d'autres. Il s’agit d’un calcul morbide effectué par une « science » actuarielle, mais aussi d’un calcul politique. Le seuil dépendra en partie de qui décède.
Dans une entrevue publiée le 8 avril, le pape François a déclaré : « Nous nous rendons compte que toutes nos pensées, que cela nous plaise ou non, sont conditionnées par l’économie. Dans le monde de la finance, il a semblé normal de sacrifier [des personnes], d’appliquer une politique de gaspillage, du début à la fin de la vie ». La faillite morale, semble-t-il, ne réside pas dans notre manque de fournitures ou de personnel médical, ni même dans notre manque de dévotion. Il s’agit d’une faillite de notre vocabulaire, de notre imagination, et de notre capacité à penser et à agir autrement. Que cela signifierait-il si nos pensées et, en fait, les termes mêmes utilisés pour formuler nos pensées, étaient colonisés par des vocabulaires, des métaphores et des idiomes économiques ?
Dans la concurrence féroce des crises - entre la santé publique et la santé économique - cela signifierait que nous ne pourrions pas naviguer objectivement entre les deux. Les termes mêmes par lesquels nous naviguons imposeraient leur parti pris économique. Parler de « santé » économique est en soi un abus de langage et un mélange des genres. Cela étant, nous ne sourcillons guère, même si nous savons que l'économie n'est pas une entité physique, et qu'une économie « saine » est toujours le résultat de souffrances, de mauvaise santé ou de mort d'êtres humains. Telle est la loi de l'accumulation du capital, la « liberté » empoisonnée des marchés libres.
Penchons-nous sur le rapport sur la bioéthique récemment commandé par le gouvernement du Québec en réponse à la crise italienne où les médecins se sont retrouvés dans la position déchirante de devoir faire des choix de vie ou de mort concernant leurs patients. Un groupe d' « experts indépendants », comprenant des cliniciens et des patients, s’est réuni pour établir des protocoles de triage des lits d'hôpitaux et des ventilateurs en cas de pénurie extrême. Le protocole est courant et démontre à quel point nous sommes prêts à céder et à appliquer un cadre économique dans le calcul de la valeur d'une vie humaine. Un certain utilitarisme prévaudra dans le triage : la même vieille « utilité » de la vie biologique éclairée par les économies et les histoires néo-malthusiennes de « valeur nette », de « valeur » et de pertes « acceptables » (voire nécessaires). Il porte un costume « clinique » pour lui donner un air d'autorité impartiale. Les patients ayant les plus grandes chances de survie biologique seront privilégiés, une considération supplémentaire sera accordée pour les résultats à moyen et long terme, et une attention particulière sera portée aux travailleurs de la santé.
Une fois encore, ces calculs ne sont pas nouveaux, mais ils deviennent plus explicites en ces temps de COVID-19. Notre « culture du gaspillage », comme la nommait le pape François, est généralement discrète et anonyme, et s'inscrit dans un système financier global et une vision du monde. À titre d’exemple, les Canadiens sont rarement obligés d’estimer la valeur de leur propre vie par rapport à celles qui sont devenues précaires en raison des trafics lucratifs d'armes canadiennes, des tests pharmaceutiques ou du travail des enfants dans des ateliers de misère. Plus près de chez nous, nous pourrions nous pencher sur la « valeur » implicite attribuée aux pauvres, aux sans-abri, aux communautés autochtones, aux prisonniers et aux personnes placées dans des établissements de soins de longue durée, dont les personnes âgées. La précarité des autres vies humaines est l' « utilité » cachée qui soutient la valeur apparente de la nôtre. Comment, alors, calculer le pouvoir et la domination ? Il est peut-être normal qu'Ananke et Bia, la nécessité et la violence, aillent de pair.
Le problème est que les termes employés dans le débat politique sont circonscrits à l'avance et délimitent les manières dont nous pouvons parler de ou même concevoir une question. Pourquoi, dans un document sur l'éthique des décisions de vie ou de mort, devrait-il sembler naturel ou juste de parler en termes économiques ? Après tout, quelle est « l'utilité » d'une vie humaine ? Qui est habilité à la mesurer, et comment ? Et par quel tour de passe-passe les principes du marché libre pourraient-ils, dès le départ, être impartiaux ou neutres ? Il semble que nous ayons accepté les termes du jeu avec une complicité tranquille, sentant parfois que quelque chose ne va pas du tout, mais manquant de moyens pour l'exprimer et vivre nos vies autrement.
Nous pourrions simplement nous demander quelle est « l'utilité » d'un virus sur l’être humain. Tester les capacités de survie des plus aptes d'entre nous, tester notre volonté collective, ou notre compassion et notre souci des autres ? Dans ces conditions, le virus pourrait, lui aussi, ressembler à un dieu.
Les manifestants, tout comme le virus, ont quelque chose de précieux à enseigner, non pas par rapport à leur discours mais plutôt pour la force qu'ils n'expriment pas vraiment en mots. Comme je l'ai dit, les manifestants ne forment pas un groupe hétéroclite ; ils n'ont pas de programme et ne parlent pas d'une seule voix. Certains souffrent certainement simplement d’ennui ou sont facilement influencés par des théories du complot. D'autres cherchent à récupérer le confort et les privilèges d'autrefois, lorsque les activités habituelles pouvaient se dérouler normalement. D'autres, plus radicaux, appellent encore au renversement de l'État, ou voudraient accélérer le « boogaloo », un terme d'argot que s’est approprié la droite indiquant l’arrivée d’une guerre civile, une guerre raciale à mener cette fois avec l'aide providentielle d'un virus qui exploite les vulnérabilités biologiques et socio-économiques. Les manifestations mettent donc à nu les lignes de faille où la collision entre la crise sanitaire et la crise économique fait éclater une crise sociale qui couvait depuis longtemps.
Les « destins » mythologiques et les « nécessités » des manifestants, leurs coups de sabre et le néo-tribalisme ont beaucoup de points communs avec la vision du monde des fondamentalistes religieux, des militants anti-vaccins, des libertaires et des « extrémistes » qui croient en autre chose. Ils semblent être attachés à d'autres dieux ou démons, se méfient de la science et de la médecine fondées sur des preuves et craignent le pouvoir de l'État. Ils ont probablement eu un certain effet sur la réouverture accélérée de l'économie dans de nombreuses collectivités publiques. Il en résultera certainement des souffrances et des décès qui auraient pu être évités.
Certes, les manifestants n'offrent pas une critique cohérente de la pensée calculatrice et des logiques économiques, mais ils devraient en engendrer une. Ils sont peut-être faciles à critiquer, mais la critique permet l’introspection et devrait nous déconcerter plutôt que de nous faire reproduire et valider ce que nous pensons déjà savoir. À cet égard, la vision mythologique du monde qui courtise le destin et la violence parodie presque l’efficacité mesurée de l'État, qui depuis si longtemps a également inscrit dans les politiques publiques les discours d’âgisme, capacitaires, racistes et économiques sur la souffrance et la mort « tolérables ». En quoi sont-ils vraiment différents ?
Les manifestants parodient nos économies cachées d' « utilité » et de sacrifice, en les exposant de manière obscène. Si nous parvenons à ne pas tourner le dos, nous pourrions, pendant un moment, discerner nos propres hypocrisies reflétées dans ces scènes, et trouver le courage de soumettre nos anciens préjugés et vocabulaires à la critique, afin de remettre en question ce qui semble « naturel » et « juste », et admettre que ceux-ci ne sont ni nécessaires, ni prédestinés. Si nous agissons de la sorte, nous aurons commencé le difficile travail de construction d'une économie post-COVID-19 qui sera plus équitable pour tous, et non pas un simple retour à la normale.
Stuart J. Murray est professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en rhétorique et en éthique à la Carleton University. S. Murray fait partie de la première promotion du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada.