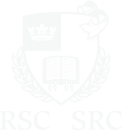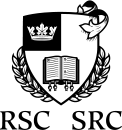Discours de réception de l’Académie des arts, des lettres et des sciences humaines
prononcé lors de la présentation des nouveaux membres de la Société royale du Canada
à l’Université du Québec à Montréal le vendredi 13 avril 2018
Madame la Rectrice,
M. le Président de la Société,
Messieurs les Présidents d’Académie,
Madame la Présidente du Collège des nouveaux chercheurs,
Mesdames et Messieurs, membres de la Société royale,
Un nain sur les épaules de géants : c’est l’expression qui m’est venue spontanément pour décrire l’émotion ressentie en apprenant mon élection à la Société royale du Canada. En entrant dans « votre distinguée compagnie », pour reprendre l’expression de Gabrielle Roy dans son discours de réception, j’ai éprouvé, pour la première fois de ma carrière, l’impression vertigineuse de ne plus me tenir à distance de mes objets de recherche, à savoir les humanistes de la Renaissance d’une part et les écrivains québécois du xixe siècle d’autre part, mais d’entrer de plain-pied dans une histoire commune, partagée avec eux, qui remonte à la fondation de notre Société en 1882.
Ainsi, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, figure parmi d’autres de mes recherches sur l’invention d’une nouvelle littérature nationale au xixe siècle, n’était plus seulement l’auteur de Charles Guérin, notre premier roman réaliste publié en 1846, il devenait, après John William Dawson, le deuxième président de la Société royale du Canada en 1883-1884.
Quant à Cyprien Tanguay, curé de Rimouski dans les années 1850 et autre objet de mes études, il n’était plus seulement le secrétaire de l’Institut littéraire de Rimouski à sa fondation en avril 1855, il devenait, en tant que membre fondateur de notre Société, une figure d’envergure nationale, reconnu pour sa contribution à la fondation d’une nouvelle discipline, la généalogie, et cela, grâce à la publication de son colossal Dictionnaire de 1871 à 1890.
De la même façon, Louis-Édouard Bois, curé de Maskinongé, n’était plus seulement l’auteur d’un étonnant roman inédit consacré à Toussaint Cartier, cet ermite qui vécut sur l’île Saint-Barnabé au large de Rimouski pendant presque quarante ans au xviiie siècle – et qui constitue une énigme au cœur de mes travaux –, il devenait, en tant que membre de la Société dès la cohorte inaugurale de 1882, l’un des plus grands érudits de son temps, du fait, entre autres, de la réédition titanesque des Relations des Jésuites qu’il dirigea en 1858 et de son impressionnante bibliothèque de quelque 5 000 volumes qu’il légua à sa mort.
Je pourrais ainsi allonger encore et encore cette liste d’écrivains, d’érudits, d’historiens qui, avant mon élection, étaient pour moi des hommes d’un temps révolu, qui m’intéressaient d’abord pour leur œuvre, mais qui sont devenus depuis des compagnons d’armes et d’études qui se survivent par cette institution à l’épreuve du temps, la Société royale du Canada, dont la riche histoire est encore trop peu connue et qui est l’un des fils conducteurs de la diversité de mes travaux d’histoire littéraire. C’est un peu comme si j’avais, à mon insu, choisi la Société royale du Canada avant qu’à son tour elle me choisisse.
À vrai dire, ces curieuses affinités électives entre notre Société et mes centres d’intérêt vont encore plus loin et concernent aussi ma prédilection pour la période de la Renaissance et le xvie siècle français. C’est que la Société royale du Canada est, comme chacun sait, l’héritière d’une double tradition et fait écho de ce côté de l’Atlantique autant à l’Institut de France et à sa fille aînée, l’illustre Académie française fondée en 1634, qu’à la non moins célèbre Royal Society de Londres créée en 1660. L’idée même de ces sociétés savantes est en fait une des plus belles inventions de la Renaissance en tant que réseaux de sociabilité fondés sur l’élection par les pairs en fonction du mérite. À ce titre, je ne peux m’empêcher de rapprocher notre Société d’une académie du xvie siècle. Il s’agit de l’Académie du Palais, la plus ancienne qui ait existé dans le monde francophone et qui réunissait certains des esprits les plus distingués et des meilleurs écrivains du règne de Henri III – Pierre de Ronsard, Jean Antoine de Baïf, Pontus de Tyard – autour de questions d’éloquence et de philosophie morale. Avec une équipe de chercheurs, nous avons étudié les traités de rhétorique à l’usage de ce roi, composés dans le cadre des réunions de cette Académie et qui expriment à merveille la persistance de l’idéal de la toute-puissance de la parole éloquente même au plus fort des sanglantes guerres de Religion.
C’est aussi à la Renaissance que nous devons l’idéal encyclopédique auquel le fondateur, le marquis de Lorne, était tout particulièrement attaché, lui qui tenait à réunir savants et artistes de tous les horizons au sein de la Société royale du Canada, et cela, dans les deux langues officielles. Le terme qui exprime cet idéal encyclopédique cherchant à restaurer et à maintenir un dialogue permanent entre tous les domaines des arts, du savoir et de la connaissance apparaît pour la première fois sous la plume de François Rabelais qui employa pour la première fois en français « encyclopédie » dans son premier roman, Pantagruel, publié en 1532. Loin de n’être que le bon vivant et le grand buveur qu’une certaine légende a inventé, Rabelais était surtout l’incarnation de cet esprit encyclopédique, véritable « abyme de science », éditeur savant, philologue aguerri, helléniste accompli, comme j’ai cherché à le montrer dans mes publications, notamment dans La rhétorique épistolaire de Rabelais (2003) et dans Rabelais éditeur du Pronostic. « La voix véritable d’Hippocrate » (à paraître aux Classiques Garnier). Au dire d’Antoine Le Roy, auteur du plus long commentaire sur son œuvre au xviie siècle, Rabelais savait tout tant « des langues mortes et vivantes que des sciences, des arts, et de toutes les belles disciplines ». C’est dire s’il mériterait d’être élu, membre honoraire de la Société royale du Canada à titre posthume.
En entrant dans cette distinguée compagnie, ce n’est pas seulement avec mes objets de recherche que j’ai trouvé des affinités. C’est aussi avec la tournure d’esprit et la démarche de nombreux membres de notre Société, à l’œuvre desquels je suis redevable, tout comme l’ensemble de la communauté des chercheurs et des écrivains. L’exhaustivité en la matière est évidemment impossible, mais je voudrais mettre en évidence certaines figures inspirantes. Je pense d’abord à une écrivaine comme Gabrielle Roy, l’auteure de Bonheur d’occasion (1945), première femme élue au sein de la section française de la Société en 1947. Je pense aussi à Adrien Thério, fondateur de la revue Lettres québécoises, élu à la Société en 1969, auteur notamment du roman Un païen chez les pingouins (1970). Or là aussi, la loi des secrètes affinités se vérifie, puisque, dans un compte rendu de ma première œuvre de fiction, La pharmacie à livres et autres remèdes contre l’oubli (2015), Michel Lord voyait une parenté et une filiation avec Adrien Thério. À vrai dire, en écrivant ce recueil de nouvelles, j’ignorais tout de l’œuvre de mon prédécesseur. Mais en la découvrant, je ne pus que lui donner raison a posteriori et me demander si je n’avais pas, à mon insu et à mon corps défendant, commis une sorte de plagiat ou d’imitation par anticipation!
Parmi les chercheurs universitaires en littérature, de nombreux noms me viennent en tête et je retiens entre autres Paul Wyczynski, grand spécialiste de Nelligan et du xixe siècle, professeur à l’Université d’Ottawa, élu à la Société royale en 1969. L’exemple de Maurice Lebel s’impose aussi comme figure emblématique des études sur la Renaissance, éditeur et traducteur du grand humaniste Guillaume Budé, professeur à l’Université Laval, élu dans notre compagnie en 1947.
Mais par dessus tout, j’aimerais revendiquer l’héritage de celles et ceux qui ont dépassé les clivages traditionnels, entre d’une part la création et d’autre part la théorie ou l’analyse littéraire. Parmi ces adeptes de ce que j’ai appelé ailleurs l’ « ambidextrie littéraire », je retiens en particulier Gérard Bessette, professeur à l’Université Queen’s, élu à la Société royale en 1966, auteur de l’un des premiers essais marquants sur la littérature québécoise, Une littérature en ébullition (1968) et de l’un des romans satiriques les plus réussis de son époque, Le libraire (1960), dont ma deuxième œuvre de fiction, Le Meilleur dernier roman paru en mars 2018, se veut, à sa manière, un prolongement et une actualisation. J’évoquerai enfin Antonine Maillet, l’auteure bien connue de Pélagie-la-Charrette (1979), élue en 1976, qui avait fait ses premières armes en littérature, en soutenant une thèse à l’Université Laval sur Rabelais et les traditions populaires en Acadie.
J’aime à penser que ma propre pratique d’historien littéraire, d’érudit et d’écrivain s’inscrit dans le sillage de ces nombreux prédécesseurs, capables de transcender les frontières disciplinaires, idéologiques, méthodologiques, nationales et linguistiques pour renouer un dialogue fécond et indispensable entre les arts, les savoirs et tous les domaines de la connaissance, dans une « circulaire érudition » pour reprendre la définition que Guillaume Budé donnait de l’encyclopédie, ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui « intersectorialité ».
C’est dire si, en étant élu à la Société royale du Canada, j’ai éprouvé – et nous éprouvons tous – une légitime fierté qui va de pair avec la conscience de l’honneur qui nous est fait, et de l’humilité qu’il convient d’adopter en pareille circonstance, celle de nains sur les épaules de géants.
Claude La Charité
Département des lettres et humanités, Université du Québec à Rimouski